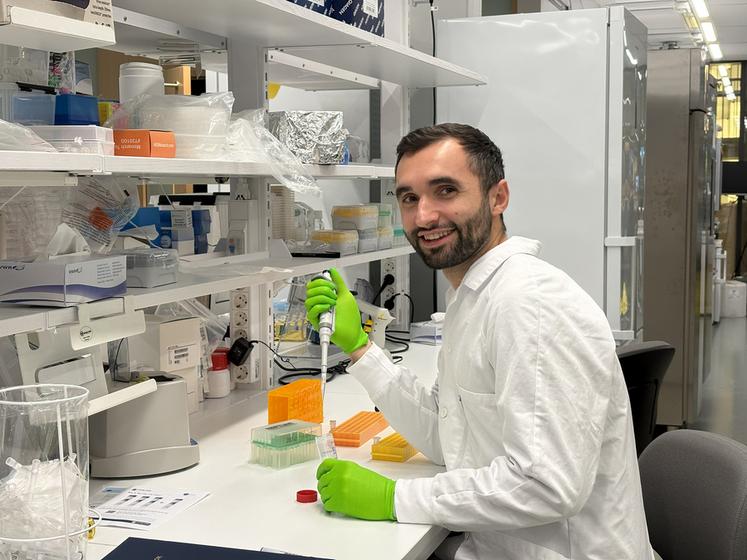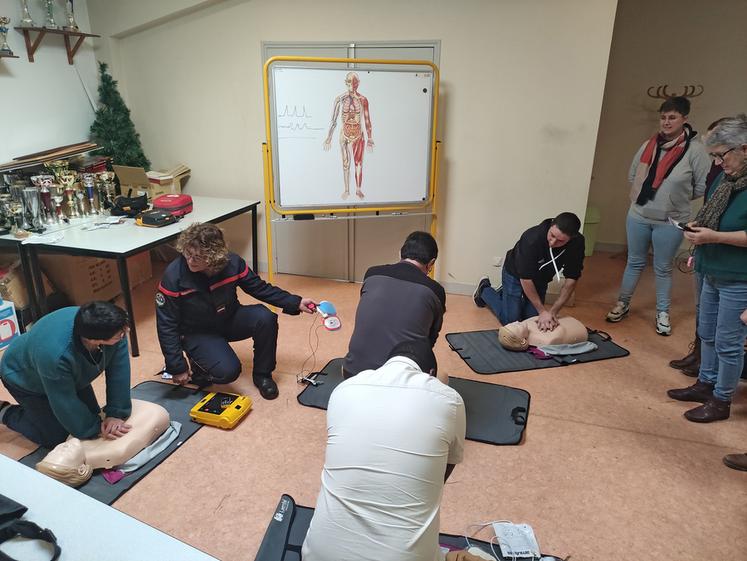Le costume berrichon, sous toutes ses coutures
De fil en aiguille, les historiens ont su capter l'essence du costume : son usage, son évolution à travers les âges, les modes, les routes de commerce apportant avec elles de nouvelles étoffes, de nouvelles matières et couleurs.
De fil en aiguille, les historiens ont su capter l'essence du costume : son usage, son évolution à travers les âges, les modes, les routes de commerce apportant avec elles de nouvelles étoffes, de nouvelles matières et couleurs.




L a culture d'un territoire passe par les vestiges immobiliers, les contes, les chants, les œuvres d'art mais aussi les éléments quotidiens, tels que les vêtements et costumes portés à une époque donnée, dans des circonstances précises. Le costume pouvait en dire long…
Ainsi, lorsque l'on étudie les costumes traditionnels de notre région, on remarque qu'ils varient selon les zones géographiques du Berry et les époques. Certaines pièces que l'on pense typiquement berrichonnes, telle que la biaude noire, n'étaient pas uniquement portées chez nous. On les recense aussi au Pays-Bas, par exemple. En effet, « la manufacture, qui les confectionnait, avait pignon sur rue et diffusait ses blouses de travail à travers des commerces locaux, sur un large secteur », retrace Daniel Bernard, historien ethnologue, qui effectue des recherches sur les costumes berrichons depuis 1982.
LA COIFFE, UN ÉLÉMENT DE DISTINCTION
Dès le Second empire (18511870), des différences vestimentaires apparaissent, surtout sur les toilettes des femmes. La coiffe variait selon la région, l'époque, mais pas que : « une paysanne ne portera pas la même coiffe que la femme du meunier ou que celle du bou-cher. Elle témoignait du rang social », révèle Daniel Bernard. Un savoir acquis grâce aux écrits, aux archives, aux objets familiaux qui se sont transmis de génération en génération.
Une paysanne ne portera pas la même coiffe que la femme du meunier ou que celle du boucher. Elle témoignait du rang social. Daniel Bernard, historien ethnologue
Tout ce qui concerne la conception des coiffes ou le symbolisme autour de certaines broderies est, en revanche, plus récent. Longtemps on a cru que les coiffes étaient brodées par les femmes aux champs lorsqu'elles gardaient le bétail. « Il n'en est rien, ou presque. Les tissus étaient brodés dans des manufactures de Tours », précise l'historien. A charge ensuite aux lingères ou aux modistes de façonner les coiffes selon les modes, les goûts et envies de leurs clientes avec une règle de base cependant : toutes les fleurs brodées étaient toujours un multiple de 7. « Le chiffre parfait, le chiffre divin, les 7 couples d'animaux dans l'arche de Noé, etc. Elément que nous avons découverts il y a peu de temps », indique Daniel Bernard. La coiffe ne semble pas encore avoir dévoilé tous ses secrets…
UNE BASE ÉCRITE SOLIDE
Autre source intarissable sur les habits d'époque, les registres d'écrous (de prison), dans lesquels les vêtements portés étaient scrupuleusement inventoriés. « On a une perception des habits, des couleurs, des tissus employés, très juste. Même si l'on sait que le/la bourgeois.e lors de sa mise aux arrêts ne portera pas ses plus beaux bijoux ou toilettes mais ne portera pas pour autant celle d'un mendiant », annote-t-il. Outre les registres d'écrous, les avis de recherche et les actes notariés offrent une photographie des garde-robes populaires. Chacun était assorti d'une estimation de la valeur de chaque pièce (en franc de l'époque). « Selon l'inventaire dressé le 7 janvier 1827, à l'issue du décès de Marie-Rose Chipault, âgée de 23 ans, vivant à Lucay-le-Mâle, on peut lire qu'il se trouvait dans sa commode, une capote de draps bleu à 24 F, une autre de droguet gris fer estimée à 12 F, un lot de 7 mouchoirs de cou de diverses couleurs en coton, indienne et mousseline pour 14 F, une paire de souliers à 3 F, ainsi de suite », énumère Daniel Bernard.
DES INFLUENCES VARIÉES
Carrefour des routes commerciales, le Berry a enrichi son patrimoine vestimentaire par l'intermédiaire les vendeurs d'imprimés, les marchands colporteurs, qui venaient des quatre coins du pays, avec des cachemires, des fichus en soie ou des indiennes dans leurs besaces. Ainsi, des similitudes sont constatées entre les châles berrichons et les châles alsaciens ou encore provençaux. « Les costumes ont été influencés au gré des marchés de textiles », poursuit l'historien.
Les costumes traditionnels berrichons s'avèrent être hauts en couleurs, malgré une dominance du bleu. Au gré des modes et des étoffes à disposition, le gris et le brun ont prédominé un temps avant de laisser place aux tons rouge, rose, lilas, violet et lie de vin des indiennes. Dans la palette, quelques exceptions toutefois : le vert était rarement demandé sauf par quelques citadines ; le jaune n'était pas utilisé car associé à la couleur de toile neuve ou de linge de maison passé. Le blanc, quant à lui, était privilégié pour les sous-vêtements et linge de nuit, fait qui est à l'origine des semaines du blanc qui sévissaient dans les commerces chaque année en janvier, il y a quelques décennies encore !
Des registres d'écrous qui en disent long
Anne Vaillant, née à Selles-sur-Cher, demeurant à La Vernelle, propriétaire de 42 ans, est entrée à la prison de Châteauroux, le 30 septembre 1858, portant une chemise en toile, une coiffe plissée, un déshabillé en drap bleu, un jupon en flanelle bleu rayée noir, un autre en futaine blanche, un autre en coton bleu, une capote en serge bleu, un tablier en coton bleu, un fichu en coton lilas à carreaux, une paire de bas en laine bleue, des chaussons en draps noir et une paire de sabots à bricole.
Quelques semaines auparavant, toujours à la maison d'arrêt de Châteauroux, Geneviève Giraudet (60 ans), née à Villedieu, demeurant à Châteauroux en tant que journalière, était inscrite au registre avec une chemise en toile grosse, une camisole bleue en coton jointe à un jupon en laine brune à raies, un tablier en treillis gris blanc, un fichu en coton brun, une coiffe en jaconas, une paire de bas en laine bleue, une paire de chaussons en laine blanche et une paire de sabots. Les descriptions étaient similaires pour les hommes.