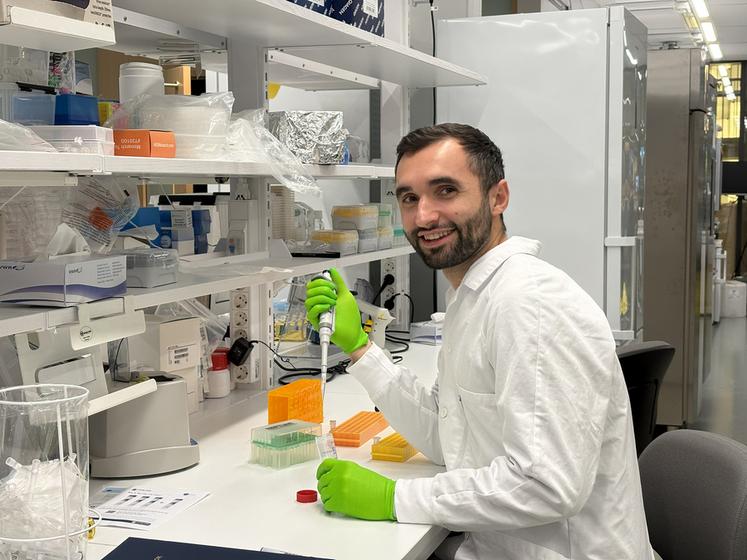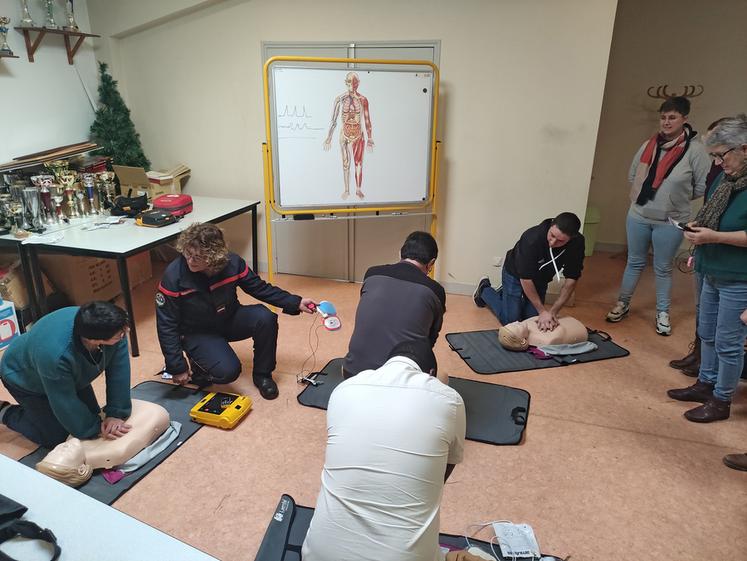L'herbe à la coupure
Les campagnes regorgent de plantes médicinales, certaines ont eu leurs heures de gloires, lorsqu'il s'agissait de soigner une plaie en urgence. Connues sous diverses appellations, l'achillée millefeuille, la consoude officinale et l'orpin reprise possèdent des propriétés appréciées des herboristes.
Les campagnes regorgent de plantes médicinales, certaines ont eu leurs heures de gloires, lorsqu'il s'agissait de soigner une plaie en urgence. Connues sous diverses appellations, l'achillée millefeuille, la consoude officinale et l'orpin reprise possèdent des propriétés appréciées des herboristes.
Elles sont trois, bien de chez nous, à porter ce nom : l'achillée millefeuille, la consoude officinale et l'orpin reprise. Un nom qui a du sens puisqu'il évoque la blessure, la plaie qu'il faut soigner sur le champ, avec les plantes que l'on a sous la main. Et, dans l'histoire, toutes les trois ont, de ce point de vue, justifié leur réputation. Ce que, très cartésien et tendance pharmacovigilance, notre aujourd'hui relativise un peu.
PLANTE AUX MILLE NOMS
L'archillée millefeuille (Achil-lea millefolium)vise une large palette de patients : elle se nomme aussi « Herbe au charpentier », « Herbe au menuisier », « Herbe aux cochers », « Herbe aux militaires », autant de professions profuses dans la campagne d'hier qui, potentiellement, prêtaient le flanc au mauvais coup faisant saigner illico : herminette hachant net un doigt, lame enfoncée dans la poitrine, la liste est longue et pas spécialement affriolante.
Son nom, rapporte la légende, est aussi celui d'Achille, l'immense héros grec qui se blessa lors de la guerre de Troie ; pour autant, les botanistes ne sont pas certains que la plante soit une habituée des confins méditerranéens. Cela dit, dès l'Antiquité, ses talents vulnéraires sont déjà connus : ainsi, Dioscoride (médecin botaniste grec du début de notre ère) puis Hildegarde, la sainte religieuse du XIIème siècle cloîtrée dans son abbaye en ont tous les deux fait grand cas pour soigner les plaies.
Qui n'a jamais croisé l'achillée millefeuille ? Elle fleurit les talus de juillet plutôt secs, tient compagnie à la campanule mauve, parfois au coquelicot et au bleuet en fin de course florale. Elle épanouit ses capitules de « petites fleurs » qui, contrairement aux apparences, ne la rapprochent pas de la carotte sauvage mais bien davantage de la grande marguerite – de fait, toutes deux sont de la même famille des Astéracées (autrefois Composées).
CICATRISATION ET CONSOLIDATION
La consoude (Symphytum officinale), elle aussi, est « Herbe au charpentier ». Robuste, elle allonge des feuilles rêches aussi râpeuses qu'une « Langue de vache » ou qu'une « Oreille d'âne » (deux autres de ses surnoms). Elle préfère l'humidité, les berges des ruisseaux où elle abonde, le fond de la prairie marécageuse où elle compose de grosses touffes joyeuses : ses corolles tubuleuses aiment varier les couleurs, blanche, rose, presque mauve, l'œil a l'embarras du choix.
Son nom parle de lui-même : il vient du latin « Consolidare » qui signifie « consolider ». Cicatriser, en langue médicale. On en usa et abusa durant des siècles, surtout sur les champs de bataille car elle possédait, disait-on, le double avantage de ressouder des plaies béantes et de consolider les fractures. C'était avant que l'on inventât le plâtrage, quand même plus efficace. Hildegarde, toujours elle, n'y va pas par quatre chemins : « Si l'on a un membre cassé ou blessé ou couvert d'ulcères, mangez de la consoude… ». On verra plus loin que son ingestion n'est pas franchement recommandée…
Pour une cicatrisation rapide
L'orpin reprise (Hylotelephium telephium), lui est un inconditionnel de la rocaille, du muret de pierre, du talus très sec. Il est aussi dit « Herbe à fève », car ses feuilles (pourtant grasses) ressemblent à celles de la fève, bien connue des agriculteurs. Il est davantage du plein été, des soirées chaudes et très ensoleillées, comme un chant étincelant à la lumière du jour. Car ses fleurs roses, presque pourpres, éclatent sur le fond pâli qui, en général, lui sert de décor, fond d'herbe sèche et de pierre claire. Et, là, surprise ! Elles composent de beaux bouquets épars que l'on a envie d'avoir chez soi, posés sur la table. Chez lui, le terme « reprise » rappelle ses propriétés vulnéraires : longtemps, on l'utilisa pour hâter la cicatrisation d'une plaie.
Mais que dit la science ?
Forte de principes chimiques et de molécules variées, découvertes, affinées et prouvées au fil du temps, la science d'aujourd'hui se méfie un peu de ce savoir venu du fond des temps. Un savoir empirique qui, via l'observation et l'expérience (laquelle marchait ou ne marchait pas : parfois, l'on mourrait, pour avoir, tel un cobaye, « goûté » à une plante qu'il aurait mieux valu se contenter de regarder des yeux), s'élaborait à tâtons dans le silence de la campagne, avant d'être refilée de père en fils, de grand-mère coureuse des bois en petite-fille poussant en sauvageonne. La science, elle, ne barguigne pas : elle réclame des preuves, sort une longue liste de principes chimiques, toxiques ou moins toxiques, bénéfiques ou pas à la santé. Ainsi, selon elle, l'orpin reprise serait d'efficacité médicale douteuse. La consoude ? idem, certes, ses propriétés vulnéraires et cicatrisantes sont reconnues, recommandées en usage externe, mais on ne sait pas précisément auquel de ses composants chimiques on les doit : de plus, si elle tient une place de choix dans la palanquée d'ouvrages racontant les plantes sauvages bonnes à manger, géniales pour soigner et se faire du bien, elle n'en contient pas moins des alcaloïdes toxiques. Autrement dit, mieux vaut ne pas l'ingérer en grandes quantités…
Quoi qu'il en soit, longtemps, ces plantes ont eu du sens et de l'utilité. Et, même si aujourd'hui, de nombreux patients leur préfèrent une chimie bien ordonnée, elles possèdent des propriétés rarement anodines – les herboristes le savent bien. Avec eux, d'autres usagers : par exemple, le jardinier qui, sur sa base fabrique le fameux « purin » de consoude, un véritable « trésor du jardin », raconte-t-il ; mais aussi le bourdon amateur de nectar et l'abeille butineuse se régalant de pollen. La nature est ainsi faite qu'elle trouve toujours à qui plaire… Et c'est tant mieux !