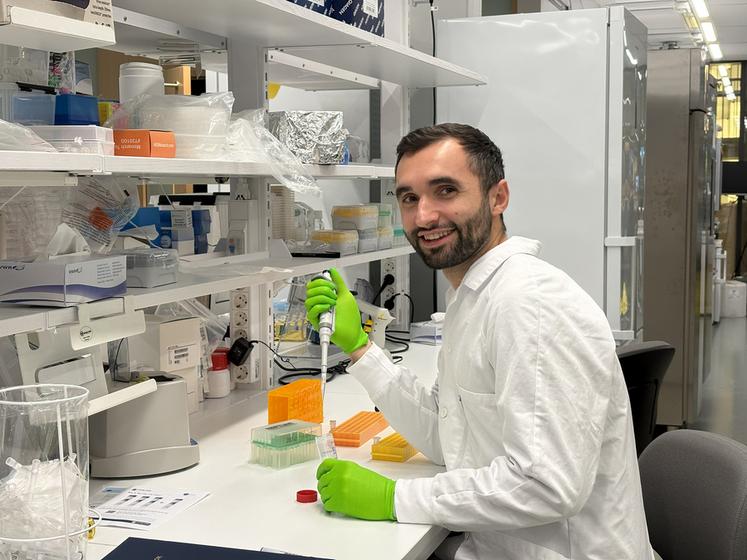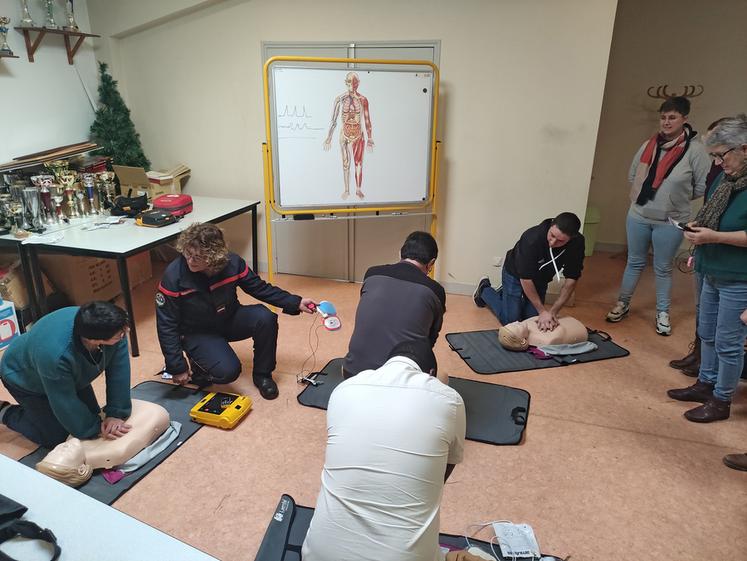PATRIMOINE
Activité minière et toponymie, hier, dans l’Indre
Sol et sous-sol sont truffés de matériaux qui, longtemps, servirent à construire la maison, finaliser le fer, consolider la route, amender les terres agricoles et satisfaire d’autres besoins, très divers. Avant l’avènement de produits industriels, type béton, ciment ou aluminium, la matière première se prenait dans le voisinage. Et, sur ce thème, la toponymie est éloquente…
Sol et sous-sol sont truffés de matériaux qui, longtemps, servirent à construire la maison, finaliser le fer, consolider la route, amender les terres agricoles et satisfaire d’autres besoins, très divers. Avant l’avènement de produits industriels, type béton, ciment ou aluminium, la matière première se prenait dans le voisinage. Et, sur ce thème, la toponymie est éloquente…



Aune époque où le fer se fabriquait sur place, les régions qui en détenaient ont, tôt dans le temps, été mises à contribution. Par exemple, dans le nord du département, « La Ferrière » à Ecueillé, « le Mineray » à Luçay-le-Mâle, deux hameaux relativement proches l’un de l’autre, nomment des lieux riches en minerai de fer. Ici, le travail d’extraction était le fait de journaliers qui grattaient le sol durant l’hiver, période de moindre activité agricole. Le minerai était ensuite, fondu dans des bas-fourneaux de type catalan.
Quoique très anciens, ces noms de lieux-dits expliquent pourquoi, durant plus d’un siècle (des années 1750 à 1870), la sidérurgie s’est développée en grand sur la commune de Luçay-le-Mâle : de fait, le minerai ne manquait pas.
Travailler le fer
Jusque dans les années 1870, époque à laquelle l’activité sidérurgique cessa dans l’Indre, la fabrication du fer nécessitait trois ingrédients : le minerai, l’eau et le bois. Mais bientôt, ce dernier fut concurrencé par l’utilisation de la houille qui, bien qu’importée, se révéla vite moins coûteuse. Dès lors, les unes après les autres, les forges locales disparurent. Or, le mot « forge » nomme un certain nombre de hameaux ou de lieux-dits : « la Forge » à Bélâbre, Chaillac, Lignac ; « les Forges » à Luçay-le-Mâle et à Vendœuvres, hameau autour duquel il n’est pas rare de trouver encore des morceaux de laitier, résidus de la combustion.
Amender le sol
Quoi de plus avare qu’une terre acide, puisque pauvre en calcaire ? Pour remédier au manque de ces précieux ions, les paysans d’autrefois entreprenaient de la chauler. Pour ce faire, par pleins charrois, ils lui apportaient la marne, ce riche matériau qui, pour un temps, faisait remonter le pH et améliorait la récolte. Raison pour laquelle, ici et là, apparaît le mot « marne » et quelques dérivés - ainsi « le Champ de la Marne », à Châtillon-sur-Indre ou Marnoux, à Mézières-en-Brenne. Mais le lieu où elle se prenait - par exemple, « la Marnière » - est également évoqué, comme à Pouligny-Saint-Pierre.
Il va sans dire que, depuis longtemps désaffectés, nombre de ces lieux-dits sont aujourd’hui boisés. Mais, sur place, se retrouvent parfois des trous et des bosses qui rappellent l’activité ancienne.
Construire la maison, monter le toit
« La Carrière », « les Carrières » : ces lieux-dits parlent d’eux-mêmes. Autrefois, on y extrayait divers matériaux - sable, pierre, argile - pour construire la maison, fabriquer la tuile ou la brique. Ces noms courent le département, de la Champagne berrichonne aux deux Boischaut, en passant par la Brenne, car ils visent autant la pierre calcaire, le granite, le schiste que le grès rouge. Quel qu’il soit, le matériau était alors partout exploité jusqu’à ce que, à partir des années 1850, les produits usinés lui fassent concurrence.
De son côté, lorsqu’il n’était pas couvert de chaumes ou de roseaux (comme en Brenne, jusqu’à la fin du XIXe siècle), le toit faisait appel à la tuile et, parfois, la fenêtre se laissait encadrer par la brique. L’une et l’autre se fabriquaient dans des ateliers qui, ici et là, donnèrent carrément leur nom au hameau. C’est, encore à Luçay-le-Mâle, « la Tuilerie », un groupement artisanal déjà présent sur le cadastre napoléonien de 1826.
À leur manière, ces quelques noms de lieux-dits évoquent des activités artisanales en lien avec la roche du sous-sol. Courantes lors des époques préindustrielles, ces dernières n’existent quasiment plus aujourd’hui et nous en avons même, pour beaucoup d’entre elles, perdu la trace. Ils disent aussi que les anciens vivaient au plus près de leur territoire, se contentant d’extraire les matériaux bruts dont ils avaient besoin, à charge pour eux de les transformer. Avec ces beaux résultats que nous voyons encore aujourd’hui, fenêtres encadrées de briques ou murs de grès rouge, de pierre blanche ou de schiste brillant au soleil.