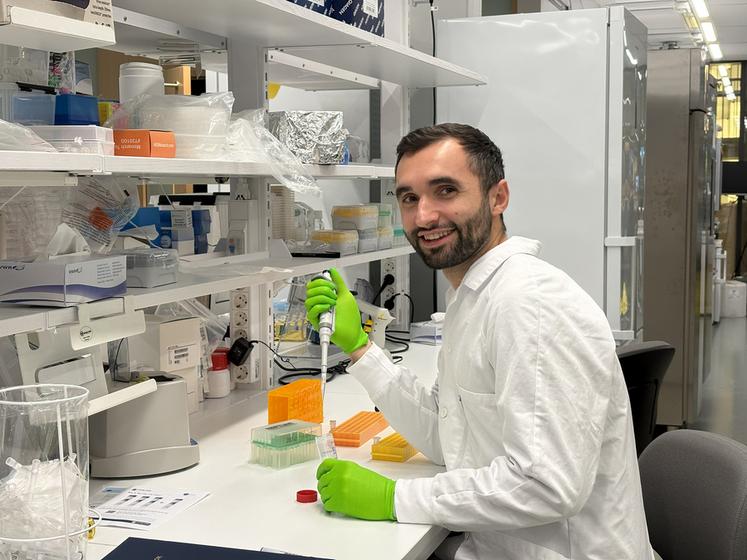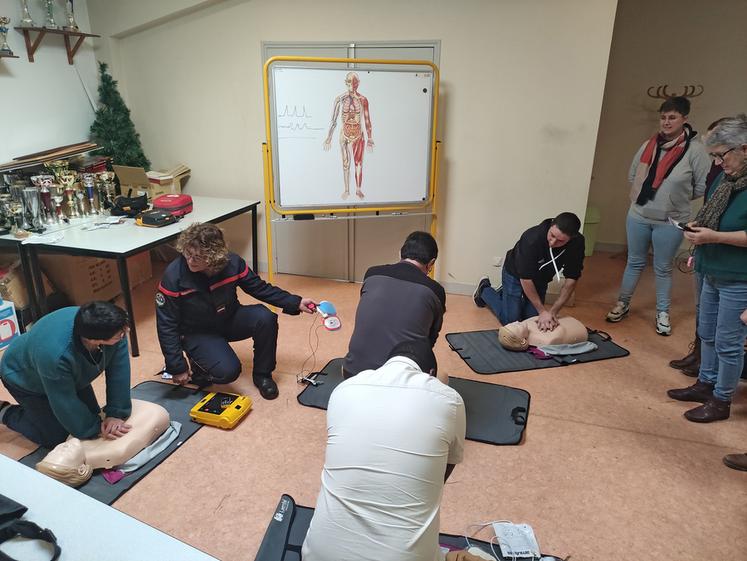BOTANIQUE
La molène, une fleur pour l’été
Elle porte le nom d’une île bretonne mais n’a pourtant rien à voir avec elle. Elle ? C’est la molène Verbascum thapsus, de la même famille des Scrophulariacées que la véronique, la digitale ou le mélampyre, aux fleurs plutôt voyantes.
Elle porte le nom d’une île bretonne mais n’a pourtant rien à voir avec elle. Elle ? C’est la molène Verbascum thapsus, de la même famille des Scrophulariacées que la véronique, la digitale ou le mélampyre, aux fleurs plutôt voyantes.

Sur taupinières, décombres, bords de chemins ou hauts de talus, elle fleurit, tête au soleil, dès que l’été pointe le bout de son nez. Et on ne peut la manquer, avec ses corolles jaunes alignées sur une tige droite, ses feuilles larges, épaisses et douces comme du velours, sa longiligne et raide silhouette qui la fait ressembler à un candélabre d’église ou à une charmante sentinelle chargée de surveiller les lieux. Cette bisannuelle ne fleurit qu’une année sur deux car elle a besoin d’un temps de dormance – l’hiver – pour germer. Raison pour laquelle, on ne la verra pas tous les ans s’épanouir à la même place.
DES NOMS VARIÉS
Les anciens la nommaient Cierge de Notre-Dame, et on le comprend fort bien au vu de sa haute taille (jusqu’à 2 m) comme de son port altier. Mais elle est aussi petit Bouillon et Herbe à Bonhomme, ce qui a quelque chose de moins fier et semble, brutalement, la ramener au ras des pâquerettes, à l’humble plancher des vaches, comme si elle portait en elle une double origine : noble d’un côté, rustre de l’autre.
GRANDE ET DURABLE
En fait, la molène Verbascum Thapsus n’est rien d’autre qu’une plante au riche caractère, certainement soucieuse de se faire remarquer comme de rendre service. Si, par sa haute taille, elle ne passe jamais inaperçue, elle possède aussi l’avantage de durer : une fois au sol, ses graines peuvent attendre plusieurs décennies, voire un siècle avant de germer. Pour cela, elles doivent disposer de conditions favorables, à savoir de la lumière et un sol dénudé, propices à éclosion – par exemple, derrière un incendie qui a fait table rase. Une seule molène va produire quantité de capsules, ces dernières contenant elles aussi des centaines de graines qui, patiemment, attendront le jour où elles pourront donner naissance à de nouvelles pousses.
DES FEUILLES TRÈS UTILES
Dans le temps paysan où rien ne se perdait, toute plante (ou presque) était utile. Avec elle, facilement, l’utile pouvait se joindre à l’agréable. Ainsi, la hampe solide de la molène finissait en torche, certes éphémère, mais torche quand même. Pour cela, une fois les feuilles enlevées, on l’enduisait de poix, de cire ou de suif, lesquelles feuilles, par ailleurs, servaient à la confection de mèches pour la lampe. Mais aussi, une fois bien sèches, à allumer le four et ce fragile combustible permettait de lancer le feu et, compte tenu de leur douceur, à molletonner des sabots durs et à isoler les pieds.
DES FLEURS POUR TEINDRE, ÉGALEMENT RECHERCHÉES DES HYMÉNOPTÈRES
Les fleurs jaunes de la molène entraient tout naturellement dans la fabrication d’une teinture qui pouvait s’appliquer tant sur la chevelure que sur un vêtement, mais la littérature rapporte qu’elle ne durait pas. L’été, ses grandes fleurs voyantes sont allègrement butinées par syrphes et abeilles chercheuses de nectar. Pas bêtes, ces insectes les fréquentent lorsque les corolles sont ouvertes, soit entre l’aube et le milieu de l’après-midi – elles se ferment ensuite – attirés par les poils très sucrés des étamines dont ils se gavent. Là encore, même modestement, la molène participe au maintien de cette petite faune.
FLEURS BIENFAISANTES, GRAINES TOXIQUES
Mais la molène vaut surtout pour ses propriétés médicinales. Autrefois, ses différentes parties servaient à soigner ces menus bobos, rhume, diarrhée ou colique, plaie ulcérée ou hémorroïde tenace qui rendaient la vie pénible. Notamment, la fleur – à condition de la filtrer car ses étamines portent des poils irritants – entre dans la composition d’une tisane, joliment appelée des « quatre fleurs pectorales » (en réalité, elles sont sept : l’antennaire (ou pied de chat), la guimauve et la mauve, le tussilage, le coquelicot, la violette et elle-même) qui pouvait calmer la voix enrouée, soigner une toux trop rauque, un coup de froid ou une bronchite. En revanche, ses graines sont toxiques. Il se rapporte même qu’autrefois, on les utilisait pour engourdir le poisson.
UNE PLANTE CONTRE LES MITES
Quoique plus courte, la molène blattaire Verbascum blattaria est pareillement visible avec ses fleurs jaunes à gorge violette, mais sans les poils cotonneux de la précédente. Egalement appelée « l’Herbeaux- mites », elle passe pour éloigner ces insectes qui, fourrés dans les lainages rangés dans l’armoire, les percent de mille trous à la grande consternation du propriétaire concerné. Familière des étés de nos campagnes qu’elle anime de ses chaudes couleurs et de sa haute taille, la molène possède donc des atouts, hier bien connus, aujourd’hui davantage oubliés.
Pour autant, reste sa propension à se poser, à se montrer, bien visible. Et, dans ce cas, rien n’est perdu : le néophyte un peu curieux ne peut qu’admirer la délicatesse de ses corolles, aimer caresser ses feuilles pareilles à du velours, sentir sa solidité. Sachant que, derrière ses beaux attributs, se cachent le secret et la promesse de quelques menus bienfaits…