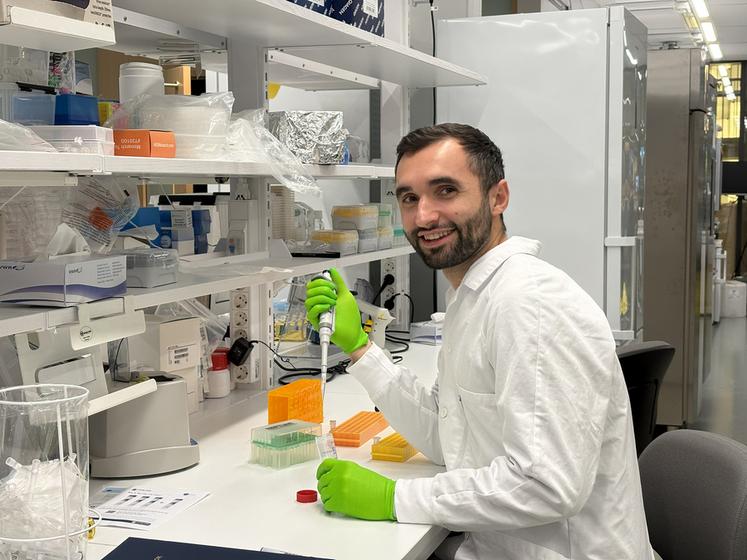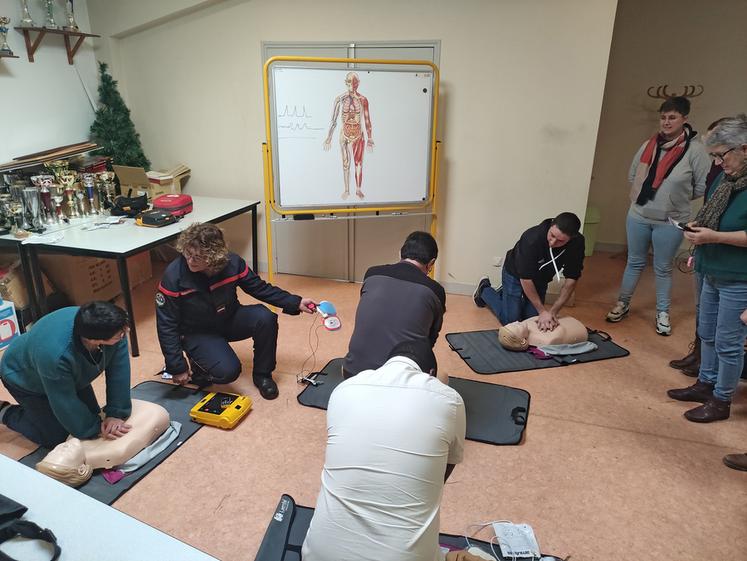L’ajonc, un peu de jaune en hiver
Dans la grisaille de l’hiver, quand les arbres déplumés et l’herbe terne semblent pleurer sous les jets de pluie, « des champs de genêts et d’ajoncs resplendissent de leurs fleurs qu’on prendrait pour des papillons d’or.»
Dans la grisaille de l’hiver, quand les arbres déplumés et l’herbe terne semblent pleurer sous les jets de pluie, « des champs de genêts et d’ajoncs resplendissent de leurs fleurs qu’on prendrait pour des papillons d’or.»

L’hiver, il est doux de porter le regard sur de menues taches de couleurs ; car au plutôt sombre tableau, elles opposent quelques gouttes de gaieté, si minuscules soient-elles : l’ajonc et son jaune puissant, quasi éternel, sont de celles-là. L’arbuste semble ne jamais vouloir défleurir : d’un bout à l’autre de l’année, il pousse ses corolles, les laisse quelque temps s’épanouir avant que d’autres ne les remplacent. C’est « l’ajonc d’or » qui sourit au passant ; ce fut aussi, mais on l’a oublié, une vraie production agricole, au temps d’une paysannerie en phase avec son territoire.
Très piquant !
Le plus connu des ajoncs - ils sont quatre en France métropolitaine - est celui qui sévit dans nos régions, à savoir l’ajonc d’Europe Ulex europaeus. Cet arbuste sait se défendre, fort de ses feuilles acérées qui rebutent l’amateur de bouquets et qu’évite soigneusement le bestiau peutêtre gourmand mais pas totalement niais, en tous cas pas au point de s’y frotter. Assez grandes et pareilles à des papillons, ses fleurs sentent la noix de coco et, en prenant quelques précautions, il est toujours agréable d’y plonger le nez ; enfin, ses fruits sont des gousses velues à l’intérieur desquelles se cachent les graines, celles-ci toxiques, il faut le noter.
Un arbuste qui fixe l’azote
Si, aujourd’hui, l’ajonc charme le paysage, il sut aussi, en son temps et dans certaines régions qui n’en manquaient pas, proposer ses services au paysan du cru. Ce dernier, qui n’avait pas la tête dans sa poche et savait regarder, sut s’en faire un précieux auxiliaire, à tel point qu’il le cultivait et en prenait grand soin. Avec le trèfle et la luzerne, la plante était alors une de ces légumineuses reconnues dont, aujourd’hui, on vante le pouvoir de fixer l’azote de l’air. A ce titre, l’ajonc peut donc, grâce aux nombreuses nodosités qui jalonnent ses racines, remplir cette fonction importante consistant à travailler en symbiose avec les bactéries utiles. Par ce biais, le sol s’enrichit naturellement en azote, (même si l’on sait qu’en parallèle, il l’acidifie), atout que le paysan d’hier avait sans doute perçu sans pour autant se l’expliquer scientifiquement.
Des landes monotones
A vrai dire, l’ajonc succède à la forêt. Une fois en place, il s’étend sans complexe, densément même, jusqu’à empêcher la reconquête des lieux par d’autres plantes qui, sans lui, auraient certainement été plus variées. Longtemps, en Brenne, mais aussi sur des parcelles acides du Boischaut sud, il forma des landes compactes. Avec lui, quelques compères, tels le genêt à balai - tout aussi jaune, mais de floraison printanière plus éphémère - et la bruyère à balai. Le tout formait alors un ensemble qui attristait le poète et indignait l’agronome savant qui ne supportait pas de voir autant de terres couvertes de cette végétation hirsute alors qu’elles auraient pu, pensaitil, recevoir la semence de ces grains utiles dont on fait le bon pain.
Une belle ressource
Certes. Mais dans une économie autarcique où, sur place, l’on prenait ce dont on avait besoin, l’ajonc était une véritable ressource, à la fois fourrage et litière, bon pour le chauffage. Ce qui n’est pas rien. Fourrage ? Cela peut surprendre. En fait, il était proposé l’hiver aux bestiaux retenus au chaud, des vaches et des chevaux qui l’acceptaient sous la seule forme de jeunes pousses encore tendres (et pas encore piquantes), au préalable broyées et hachées ; moyennant quoi, il entrait dans la ration alimentaire, servi d’autant mieux qu’il se coupait de novembre à mars et qu’il était de bon rendement. Tant d’atouts expliquent qu’on le nomma « la luzerne des pays pauvres ». Et, toujours en ces régions où il abondait, il donnait une belle litière, à la fois douce et absorbante tandis que, séchées en fagots, ses vieilles tiges finissaient dans le four domestique. Rien ne se perdait…