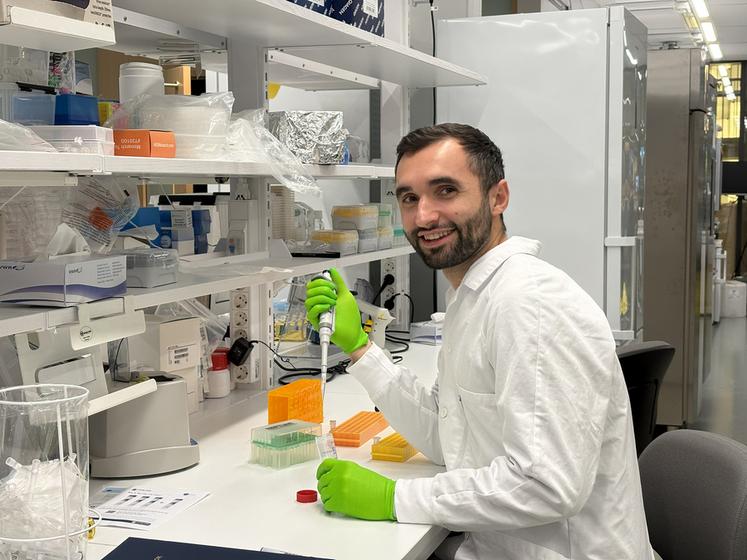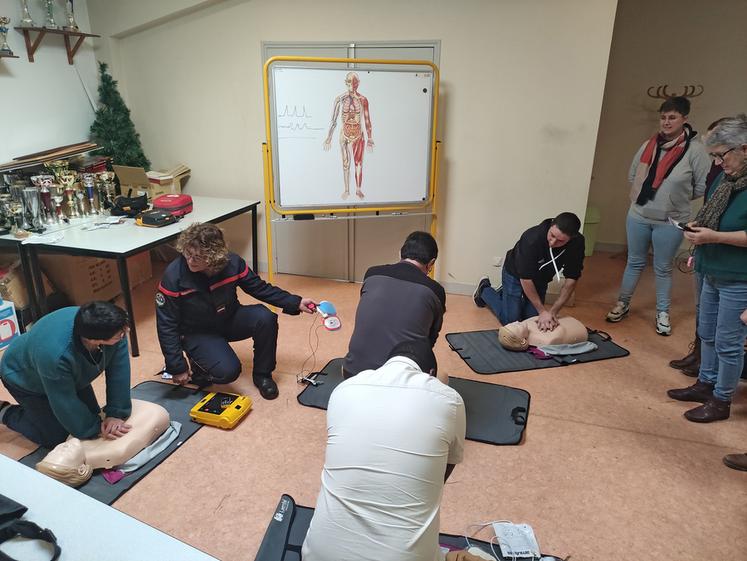Première Guerre mondiale
Les femmes au pouvoir dans les exploitations agricoles
Au hasard, d'une brocante, dans une boîte en carton, plus de 200 lettres dormaient. Mise à jour par Jérôme Charraud, la correspondance entre Louis et Louise Poitrenaud est une fresque très précise du monde rurale où les femmes sont devenues des cheffes d'exploitation à part entière, avec toutes les décisions et initiatives qui en découlent.
Au hasard, d'une brocante, dans une boîte en carton, plus de 200 lettres dormaient. Mise à jour par Jérôme Charraud, la correspondance entre Louis et Louise Poitrenaud est une fresque très précise du monde rurale où les femmes sont devenues des cheffes d'exploitation à part entière, avec toutes les décisions et initiatives qui en découlent.

En 1914, la mobilisation générale à l'effort de guerre a profondément bouleversé la vie des citoyens. Le monde agricole a vu ses bras partir pour défendre les couleurs du pays. Cependant, champs et animaux n'ont pas été abandonnés. Épouses, mères et filles d'exploitants se sont unies pour remplacer les hommes et prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la ferme. Le quotidien d'une de ces femmes, Louise Poitrenaud, est raconté très précisément dans une correspondance de plus de deux ans avec son époux Louis. « Ces lettres sont des témoignages vraiment exceptionnels. Louise Poitrenaud nous fait une véritable chronique du quotidien de tout un village au cœur de la Première Guerre mondiale », s'émerveille Daniel Bernard, historien et auteur de l'article « Vivre à la campagne pendant la Grande Guerre ».
APPEL À LA TERRE
En 1915, Louis Poitrenaud est appelé à la caserne Ruby de Châteauroux pour servir en tant qu'infirmier militaire. Il laisse derrière lui sa femme Louise, sa fille Marie-Rose et toute son exploitation, dans le village des Pauduats à Saint-Gaul-tier. Les époux ne s'échangent pas moins de 200 lettres en deux ans. Une riche correspondance dans laquelle s'exprime la vie quotidienne de la nouvelle cheffe d'exploitation. En effet, dès le 12 mai, Louise se retrouve à la tête de la ferme où elle va devoir cultiver différentes céréales (blé, avoine, marsèche, maïs), mais aussi des betteraves, des pommes de terre, des pois, du sainfoin et du trèfle. La jeune femme poursuit également l'entre-tien du potager de son époux, ainsi que celui de la vigne. Elle ajoute des ovins, des bovins, quelques chèvres et des cochons à l'élevage de gallinacés dont elle s'occupait déjà avant la guerre.
« C'est une correspondance paysanne extraordinaire, souligne Daniel Bernard, qui permet de voir comment les femmes ont pris le relai, se sont occupées de tout : fermes, enfants, commercialisation, gestion de la main-d'œuvre, des travaux, administration etc. ». À travers son patois et des tournures locales, Louise livre à son mari un véritable compte-rendu des actions menées sur l'exploitation. Pour autant, c'est bien elle qui est l'instigatrice des travaux.
SOLIDARITÉ AGRICOLE
Au fil du calendrier rural, viennent et reviennent les labours, les se-mailles et les couvrailles, la taille de la vigne, la fenaison, les moissons, les battages et les vendanges. « A l'époque, il n'y avait pas d'individualisme dans le monde agricole. L'entraide était très présente. Ce fût encore plus le cas pendant la Grande Guerre », explique l'historien. Au cours des missives, Louise détaille ses travaux à son mari. Elle mentionne régulièrement sa famille et sa belle-famille très présentes sur l'exploitation. Aux Pauduats, les voisins aussi se rassemblent et s'organisent pour effectuer les travaux agricoles, afin que chaque exploitation puisse tirer son épingle du jeu. Mais malgré toutes les bonnes volontés, la solidarité ne suffit pas. Dus au manque d'ouvriers, les retards dans les récoltes s'accumulent et les aléas météorologiques menacent les cultures. En juin 1916, Louise incite sa famille et celle de son époux à l'achat d'une faucheuse. Cette initiative d'achat commun va leur permettre à tous de réussir à finir les cultures dans les temps. « Il est même possible que cette faucheuse ait servi au village entier, tant la solidarité était importante », ajoute Daniel Bernard.
L'ESPOIR DES PERMISSIONS
Au cours de la correspondance, les mots témoignent du poids de la guerre sur le moral du couple. Louis Poitrenaud désespère de ne pas obtenir de permission agricole. Les dossiers se bousculent aux portes des instances militaires administratives. Pour obtenir une permission agricole, il faut que les soldats présentent, en amont, un certificat attestant du nombre d'hectares dont ils disposent. Louise se dote de cette tâche administrative.
En plus du travail des champs, des soins donnés aux animaux et de l'éducation de sa fille Marie-Rose, Louise se charge donc de demander des certificats à la mairie de Saint-Gaultier. Régulièrement, elle s'y rend, dans l'espoir que son époux revienne la seconder quelques temps dans l'exploitation. Pourtant, malgré de nombreux certificats écrits et envoyés, peu ont abouti à une permission. Louise Poitrenaud a donc dû gérer d'une main de maître l'ensemble de l'exploitation de son mari jusqu'à son retour en 1917.
Si les femmes n'avaient pas pris les rênes des exploitations en temps de guerre, la France ne se serait pas relevée sans peine. Nombreux sont les hommes qui ne sont pas revenus. Nombreux également sont ceux qui en sont revenus mutilés ou physiquement touchés, les rendant inaptes à l'activité agricole. De nombreuses femmes ont donc continué d'assumer leur rôle de chef d'exploitation au retour des hommes. À l'époque, toutes exerçaient sur les terres de leur époux. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'installer dans leur propre exploitation. En 2021, 62 % des femmes travaillant dans le domaine de l'agriculture étaient cheffes d'exploitation. Une belle preuve de leur prise d'indépendance dans le milieu.