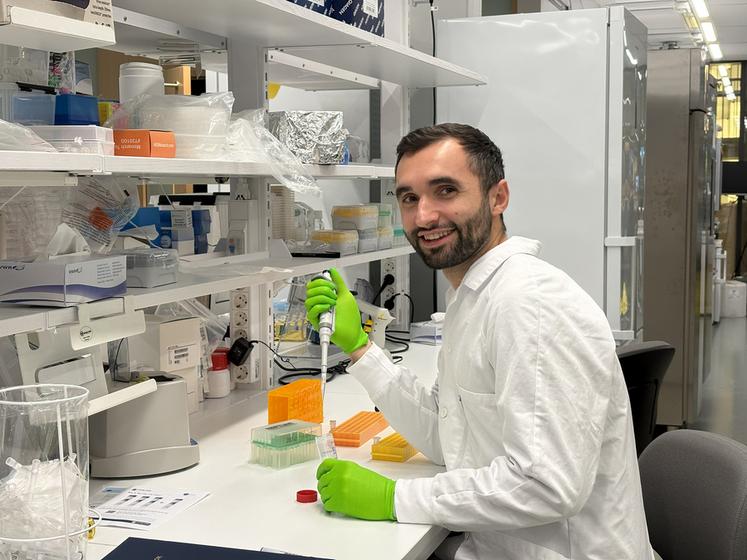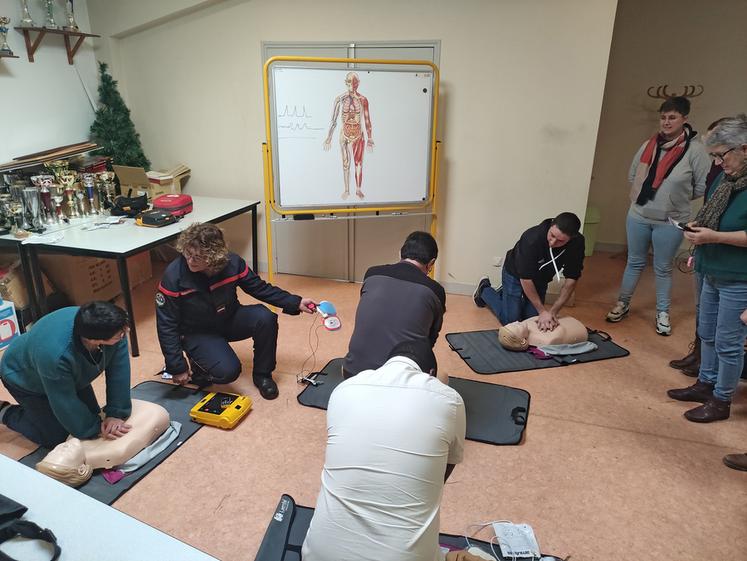Noms de plantes : attention aux faux amis
Depuis qu’il les côtoie et les utilise, l’homme lambda nomme les plantes. Mais à sa manière, pas toujours scientifique ce qui, parfois, fait sursauter le puriste sachant. D’où des quiproquos et des approximations, voire des erreurs.
Depuis qu’il les côtoie et les utilise, l’homme lambda nomme les plantes. Mais à sa manière, pas toujours scientifique ce qui, parfois, fait sursauter le puriste sachant. D’où des quiproquos et des approximations, voire des erreurs.



L’homme, n’ayant pour lui que sa connaissance, pragmatique et de voisinage, remarque surtout les plantes qui lui sont utiles au plan médical, fourrager, pour bâtir sa maison, etc. Il remarque aussi celles qui, grosso modo, se ressemblent sans être pourtant de la même famille. Sauf lointain cousinage. Quelques exemples.
« L’HERBE À LA COUPURE »
Elle est bien connue : c’est le nom que l’homme donna à des plantes aussi différentes que la consoude officinale Symphytum officinale, l’orpin reprise Sedum telephium ou l’achillée millefeuille Achillea millefolium, toutes trois vulnéraires réputées pour soigner plaies et bobos saignants. Egalement appelée « oreille d’âne » – bien qu’elle ne soit pas la seule – à cause de la forme de ses feuilles, la première pousse près de l’eau. Son nom scientifique français (consoude) l’indique, elle aide à cicatriser : de fait, elle « consolide », répare et soigne plaies suppurantes et brûlures profondes. Quant à l’achillée millefeuille, qui est aussi « l’herbe aux charpentiers », l’homme du métier l’appliquait fissa sur un méchant coup de hache ou de couteau. Pour autant, la science d’aujourd’hui indique qu’il ne vaut mieux pas l’utiliser sur une plaie fraîche.
« L’HERBE À LA FIÈVRE » ET QUEUE DE RENARD »
Dans « l’herbe à la fièvre », se reconnaissent l’angélique sauvage Angelica sylvestris, la douceamère Solanum dulcamarum et la benoîte Geum urbanum. Là encore, ces trois plantes étaient censées faire plier la fièvre ou, plus sûrement, accompagner le convalescent en voie de guérison. Vrai pour la première, même si ses propriétés ont été un peu exagérées ; mais beaucoup moins pour la seconde, connue pour sa relative toxicité : d’ailleurs, mieux vaut éviter de goûter ses fruits rouges pareils à des groseilles car, et ce n’est pas un hasard, elle s’appelle aussi « crève-chien »… Enfin, si la benoîte, proche du fraisier, porte la gentillesse en elle – elle est aussi « Herbe du bon soldat » – elle est tout juste bonne à soigner un léger état fébrile. Quant au terme « queue de renard », il s’applique à quantité de plantes. Par exemple, la prêle Equisetum arvense, bien connue de l’agriculteur qui redoute qu’elle n’envahisse son champ – il la nomme aussi « queue de Chat » ou « queue de Rat ». Il vaut aussi pour le vulpin Alopecurus pratensis, pas davantage apprécié et la massette Typha angustifolia que son long cigare épanoui à la fin de l’été, signale au bord des étangs. Et quelques autres encore.
ORTIE ET ORTIE
S’il est une plante dont le nom prête à confusion, c’est bien l’ortie. Mais qui ne s’est pas déjà frotté à « la vraie », à sa piqûre suivie de cloques rouges ? C’est la grande, Urtica dioïca dont on fait de bonnes soupes dans le jeune printemps, celle que les puristes utilisent pour fertiliser le jardin, le prix en étant une odeur pas franchement agréable. C’est encore U.urens, certes plus courte mais ô combien plus brûlante ! A côté, il y a une flopée « d’orties » issues de la famille des Lamiacées. Certaines du genre Lamium sont colorées : il y a la pourpre L. purpureum, bien connue au jardin, la jaune L. galeobdolon qui fleurit dans les bois d’avril. D’autres, toujours de la même famille mais d’un genre différent sont plus méchamment nommées « la puante » Stachys sylvatica ou « l’épineuse » Galeopsis tetrahit, car de contact un peu rude.
DE L’EMPIRISME À LA SCIENCE
Cependant, ce vocabulaire sensuel tend à tomber dans l’oubli, méconnu des nouvelles générations. A côté, s’impose la science qui classe, ordonne et nomme en latin, cette langue scientifique qui permet à tout botaniste de ne pas se tromper. Le paysan d’hier savait observer, écouter le bruissement de la feuille, sentir la fine odeur de la fleur juste éclose, palper le fruit, voire converser avec la plante posée devant lui, puis la tester et parfois à ses risques et périls. Raison pour laquelle, s’il ne faut surtout pas s’éloigner de la stricte nomenclature scientifique, la seule à être gage de rigueur, il n’est pas interdit de s’attarder sur ces noms d’un autre temps. Histoire de rêver…