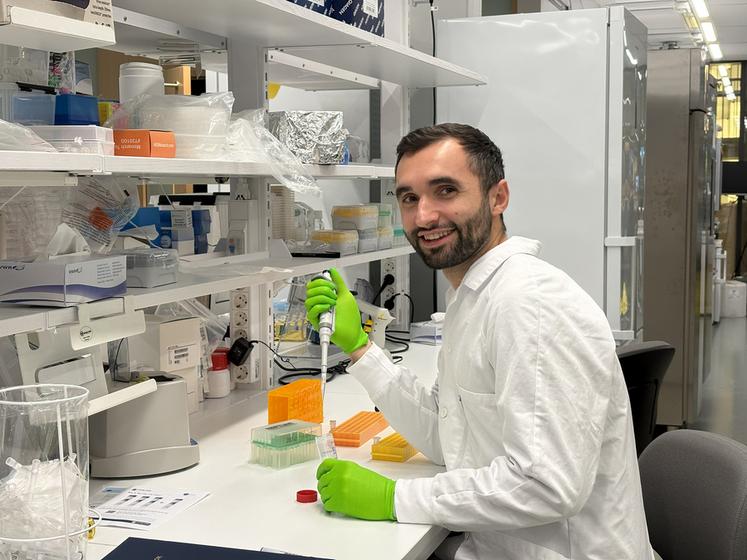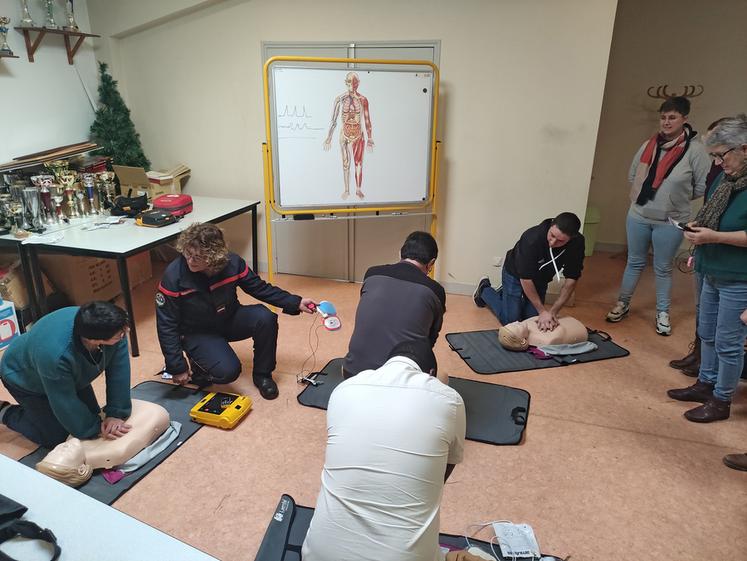Petit train d’hier, voie verte d’aujourd’hui
Dans les campagnes, la « Voie verte » a remplacé le rail. Il y a un petit siècle, pourtant, au long d’une ligne impavide qui reliait les villages les uns aux autres, filaient de petits trains tranquilles transbahutant personnes et marchandises. Aujourd’hui, la voie reste mais fréquentée par des piétons et des vélos, des coureurs à pied et, parfois, des poussettes.
Dans les campagnes, la « Voie verte » a remplacé le rail. Il y a un petit siècle, pourtant, au long d’une ligne impavide qui reliait les villages les uns aux autres, filaient de petits trains tranquilles transbahutant personnes et marchandises. Aujourd’hui, la voie reste mais fréquentée par des piétons et des vélos, des coureurs à pied et, parfois, des poussettes.

A l’époque, ce qui valait pour le petit B.A. – ligne Le Blanc (Indre) - Argent (Cher) par Buzançais, Ecueillé, Valençay – et ses presque 200 km, valait aussi pour les nombreuses autres lignes qui sillonnaient le département de l’Indre. Comme une fine toile d’araignée, c’était tout un réseau qui drainait et irriguait le pays en son entier. A ce pays et jusque dans ses recoins les plus profonds, il apportait un air nouveau, parfois d’insolites changements. Grâce à lui, autour d’Argenton sur Creuse, de La Châtre, de Chaillac et de tant d’autres gros bourgs, les campagnes s’arrimèrent au monde extérieur. Ce fut une quasi-révolution, d’habitudes et de productions : les premières se virent profondément bouleversées et les secondes s’accrurent.
A LA PLACE DES CHEMINS PAYSANS
Commerce, agriculture et industrie étaient à la une. Près des forges et des distilleries, des marnières inépuisables et des terres à gazette, des labours propices aux moissons et des prés fournisseurs de bœufs gras, les wagons chargeaient et déchargeaient les produits tirés de la terre et des savoir-faire locaux. Avec leurs ornières et leur sol parfois détrempé, les chemins paysans sur lesquels cahotaient les charrois ne suffisaient plus ; même, ils devenaient obsolètes et quasi ringards. Ils furent alors relégués en seconde zone, juste bons à assurer le transport de marchandises légères entre deux points pas trop éloignés l’un de l’autre.
GARES DE VILLAGE ET HALTES DE CAMPAGNE
Personnes et marchandises. Pour cela, il fallait des lieux où les transborder, c’est-à-dire des gares de village, des haltes en rase campagne – par exemple, au Blanc –, lesquelles se succédaient tous les 2 ou 3 km. Si, dans les secondes, le (la) garde-barrière se bornait à abaisser puis à remonter sa barrière, et les voyageurs à sauter dans le train ou à s’en jeter, dans les premières en revanche, il fallait concilier le transport des hommes, bêtes domestiques et biens divers, tous embarqués dans un même convoi. Pour cela, il y avait des locomotives poussives et des wagons brinquebalants, des manœuvres diverses et parfois approximatives, des horaires élastiques, des coups de sifflet partant dans tous les sens ; mais aussi, de la bonne humeur et de l’admiration face à cette petite merveille technologique qui, pour nous, n’est rien d’autre qu’un banal petit train de campagne.
UNE NOUVELLE VIE
Aujourd’hui, ces lignes domestiques ont disparu, les liaisons entre Paris et les grandes villes ayant raflé les investissements ferroviaires. Les petites haltes sont devenues des résidences achetées par des retraités désirant y finir leurs vieux jours, par des familles pleines d’enfants et des citadins qui en faisaient une maison secondaire. Quant aux lignes proprement dites, elles étaient carrément abandonnées, laissées à la friche, parfois désossées et tronçonnées. Vendues à des propriétaires privés, c’en était fini des liaisons entre bourgs… A moins qu’elles ne passassent aux mains de la collectivité qui s’empressait de les transformer en voie verte, offerte à la randonnée, le vélo et la course à pied.
ET DE NOUVELLES FONCTIONS
C’est alors que le goudron gris remplaça les rails bien alignés ; de leur côté, les bas-côtés restaient inchangés. Parfois, on les agrémentait d’un banc de bois pour le repos du promeneur. Si bien que, régulièrement, la Voie verte accueille des flopées de cyclistes casqués, les uns cheminant en famille, les autres entre copains, des retraités moins rapides mais devisant gaiement.
QUE DIT LA NOSTALGIE ?
Reste la nostalgie et la survie très localisée, dans le temps comme dans l’espace, de ces petites voies qui, il y a un siècle, tournaient à plein régime, sous le regard pensif des vaches au pré. C’est ainsi que, sur de courts tronçons – ainsi entre Luçay-le-Mâle et Argy – remis d’aplomb par une poignée de bénévoles enthousiastes, le petit train s’est remis à sillonner la campagne. Le temps d’un dimanche aprèsmidi, il permet au citadin en mal de nature ou curieux de connaître les lieux de vie de ses ancêtres paysans, de découvrir des paysages bucoliques. Ancêtres qui, peut-être comme lui, empruntèrent la petite ligne. Mais les temps ont changé : aujourd’hui, outre que les paysages ont bougé, on monte dans le train pour respirer des bribes d’histoire et se faire plaisir alors qu’hier, le travail commandait, le repos n’était pas à l’ordre du jour et la fête très occasionnelle…