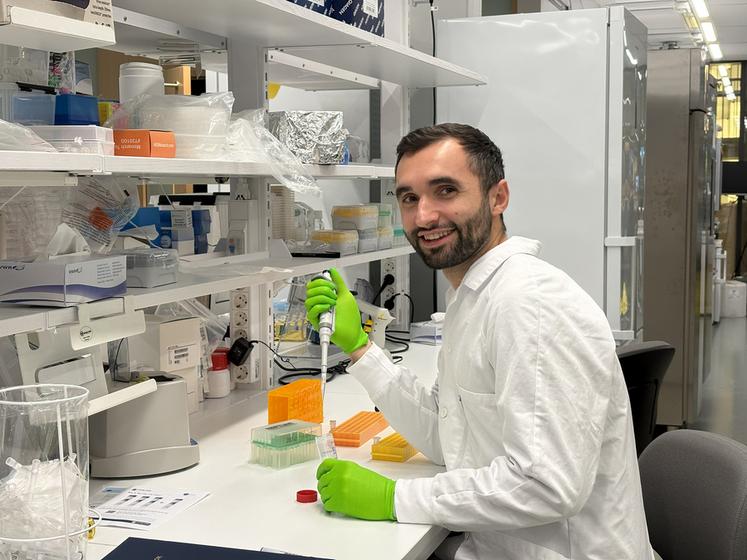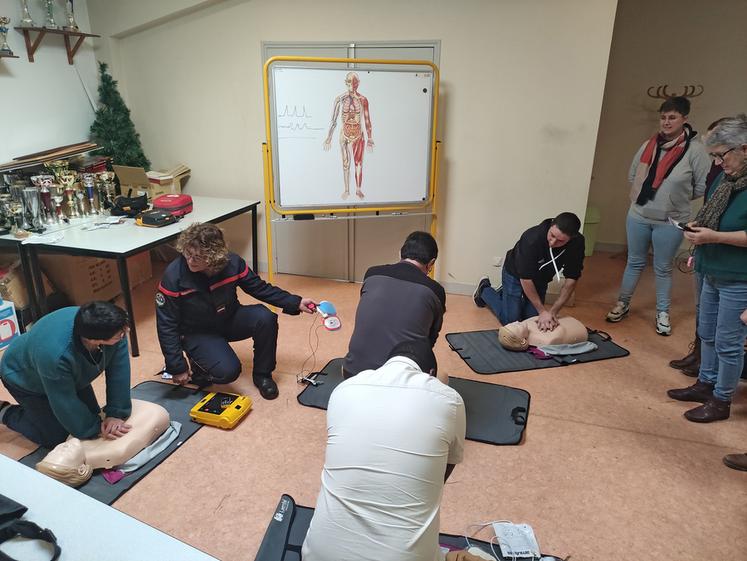PATRIMOINE
Des étangs pour nourrir le bétail
Moins riches, mais précieuses, elles offrent fourrage, fraîcheur et entretien naturel des paysages.
Moins riches, mais précieuses, elles offrent fourrage, fraîcheur et entretien naturel des paysages.



Dès la mi-juin, une chape de chaleur inhabituelle précipita la pousse de l’herbe qui, en quelques jours seulement, passa très vite du vert tendre au jaune pâle. Si pareilles surprises climatiques avaient déjà eu lieu dans le passé, ce fut toujours plus tard en saison. Mais les faits sont bien là : les prairies sont comme des paillassons, les mares réduites à l’état de flaques fangeuses et les ruisseaux asséchés. En Brenne, pour résister au mieux à cette vague, chaude et puissante, l’étang devient recours. Comme autrefois.
En réalité, l’étang d’hier ne se contentait pas de produire du poisson : les petites métairies voisines en exploitaient aussi les abords, zones mouillées riches en carex et roseaux, que fréquentaient volontiers les bovins. L’été, ils y passaient une partie de leur temps, naviguant entre l’herbe plus tendre de la prairie riveraine et la ceinture végétale qui bordait le plan d’eau. Ils changeaient pourtant de menu lorsque, fourrageant dans les roseaux, ils en croquaient les tiges coriaces et les feuilles coupantes, certainement moins nutritives que les pousses vertes d’à côté. Mais, alors, c’était mieux que rien.
Le pacage au bord de l’étang, une rente supplémentaire
Pour le propriétaire, la périphérie de l’étang constituait une rente supplémentaire. Car à ce produit phare qu’était le poisson, il ajoutait le fermage de la prairie proche. Le marquis de Lancosme l’évoque assez bien : « Quant au pacage, foin et litière qu’on peut retirer des étangs, c’est une valeur plutôt relative que fixe. Indispensables pour la nourriture et l’abreuvage des bestiaux, il est surtout d’un grand secours en printemps quand il n'y a aucune herbe nulle part, les plantes aquatiques poussant de bonne heure donnent au bétail une nourriture peu substantielle, mais rafraîchissante ». Même s’il ajoute : « Le foin qu’on récolte sur les bords est de très mauvaise qualité et la litière fait du fumier bien maigre, il n’y a que dans les grands étangs et ceux qui sont marécageux qu’on puisse faucher abondamment... »*
Des pratiques qui durent
Un siècle plus tard, en 1931, Jean Goyon confirmait : « … En raison de l’absence de sources, les étangs étaient indispensables pendant la saison sèche à l’abreuvement du bétail… et leurs rives lui fournissaient une nourriture qu’il ne pourrait plus trouver dans les pâturages brûlés de l’été. Sans eux, pas d’élevage possible. La meilleure preuve est le prix élevé du droit de pacages… ». De plus « les étangs favorisent également beaucoup l’élevage des oies qui ont besoin constamment de l’eau à proximité… »**
Aujourd’hui, un appoint non négligeable
Aujourd’hui, et les éleveurs brennous en sont certainement tous d’accord, le fourrage directement tiré de la ceinture végétale de l’étang ne vaut certainement pas un bon trèfle ou un bon ray-grass ; pour autant, il a le mérite d’exister, de nourrir et d’occuper le bétail, d’éviter d’entamer trop vite le foin récolté sur les zones plus sèches ; il a aussi cet avantage d’employer le bétail à un travail d’entretien appréciable : en mangeant les jeunes pousses de saules, ce dernier en limite la progression, évitant qu’elles ne s’étendent au détriment d’autres espèces végétales. Ajoutons aussi que les vaches y trouvent une fraîcheur bienfaisante.
De plus, et les études scientifiques le montrent bien, ces aliments un peu frustres, directement puisés dans la roselière, ne sont pas sans intérêt : certes, ils ne remplissent pas, ou mal, la panse et les feuilles tranchantes peuvent, à l’occasion, provoquer quelques blessures, mais elles ont l’avantage d’être riches en certains nutriments, plus rares dans les fourrages classiques. Et si, aujourd’hui, les oies ne sont plus d’actualité, du moins au bord des étangs, l’éleveur reste convaincu que la rive de l’étang garde un intérêt certain, surtout en période de sécheresse et de disette prairiale.
* Marquis de Lancosme, Enquête sur la Brenne, 1842.
**Jean Goyon, Essai sur la Brenne agricole, 1925.